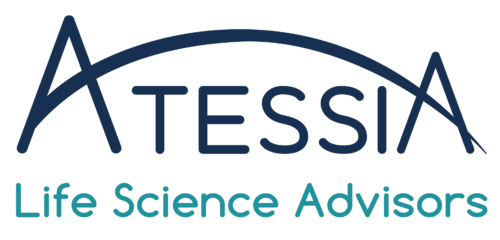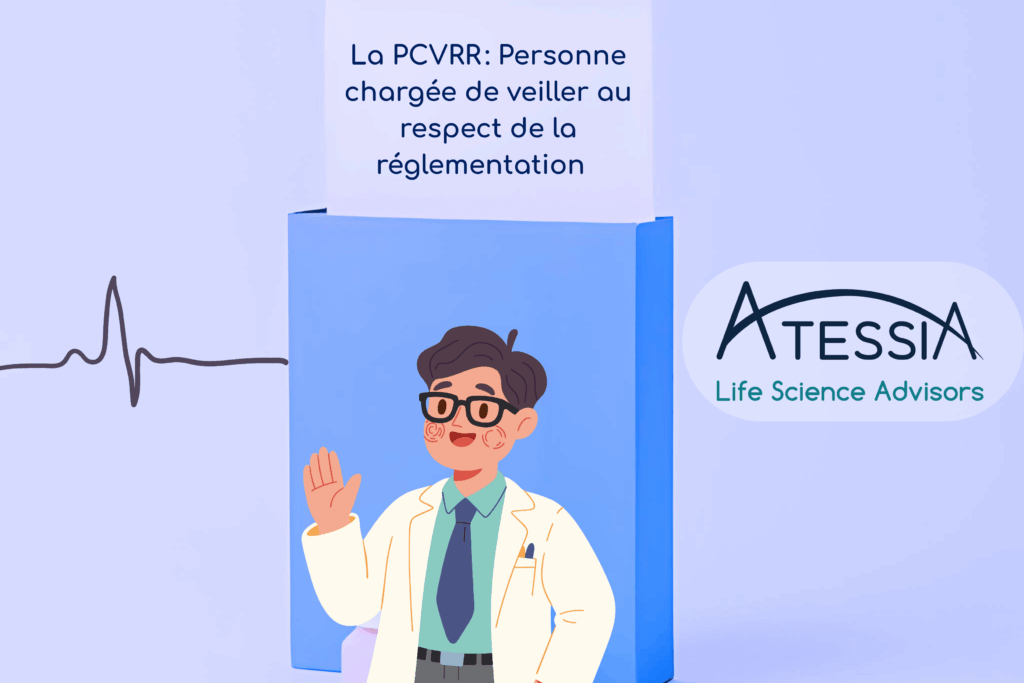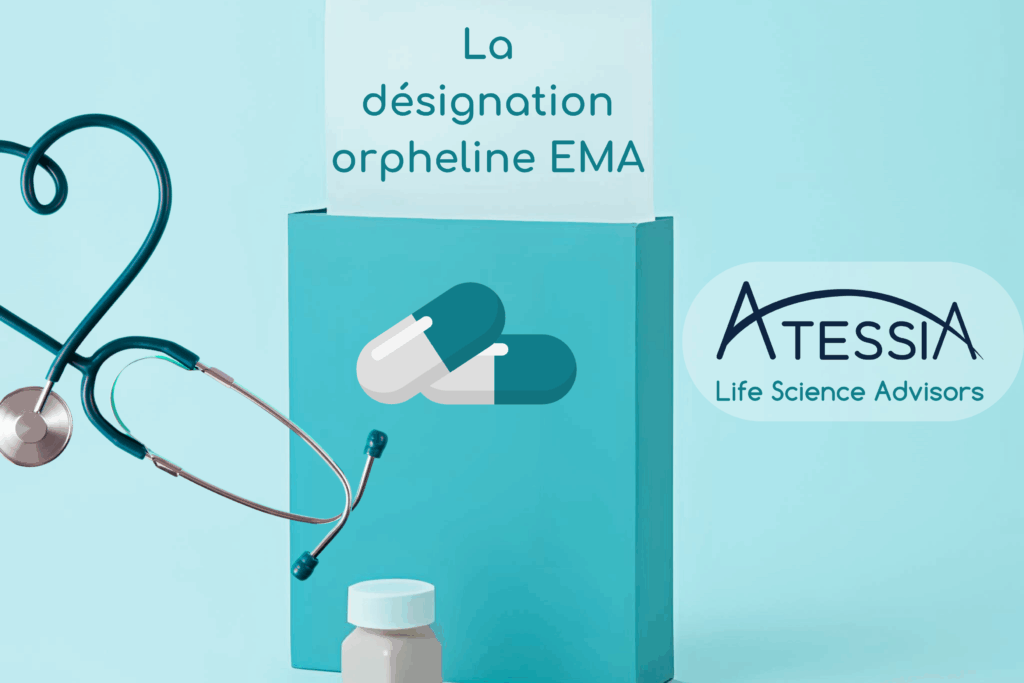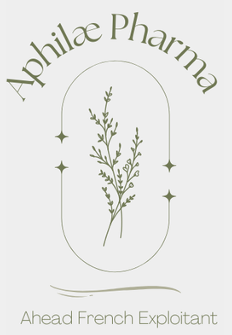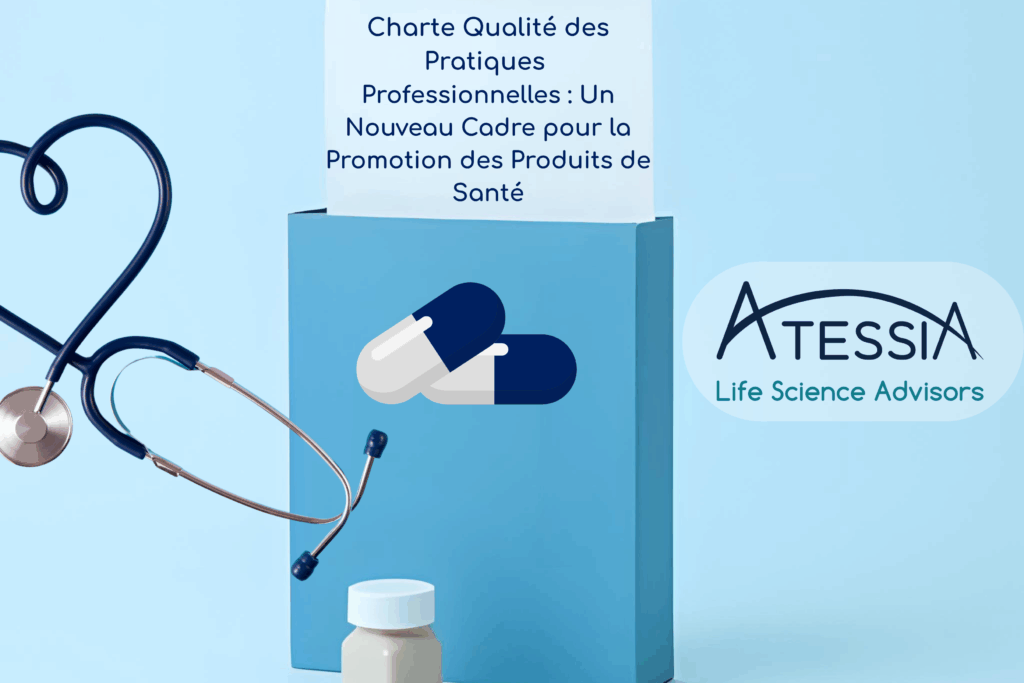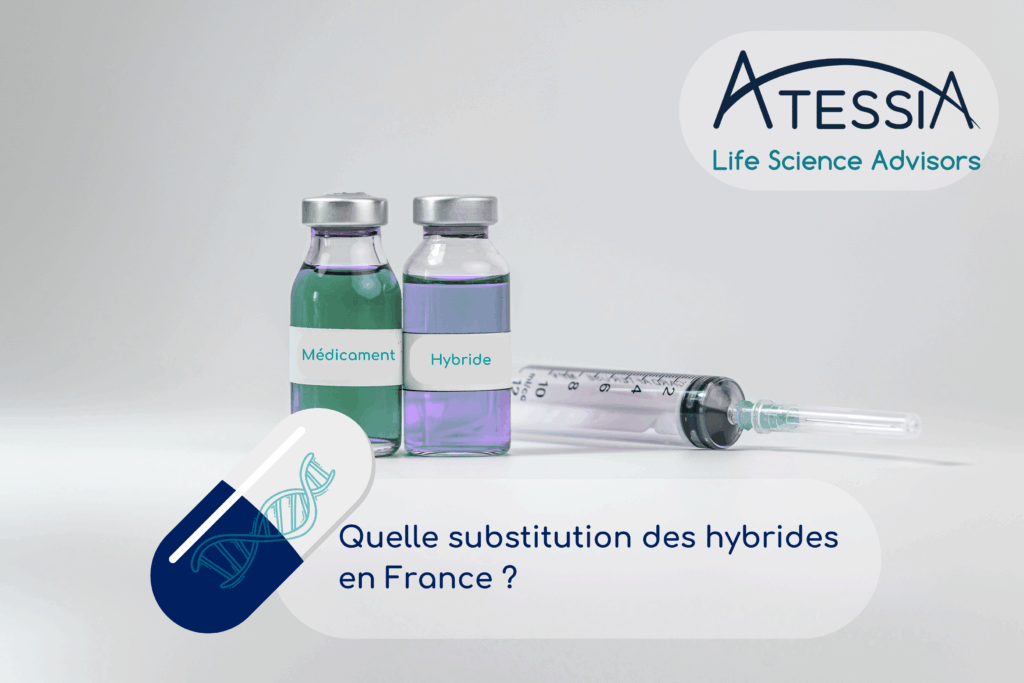Comment gérer une MPUP non GMP dans vos dossiers d’AMM ?
Les substances mises en œuvre dans un médicament destiné au marché européen, y compris en vue de son exportation, sont définies comme des matières premières à usage pharmaceutique (MPUP). Elles peuvent être actives (substance actives) ou inertes (excipients).
Que les médicaments soient destinés à un usage humain ou vétérinaire, seules des substances actives fabriquées et distribuées conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication européennes (BPF – Part II) et aux Bonnes Pratiques de Distribution (BPD), introduites par l’article L.5138-3 du CSP, peuvent être mise en œuvre.
Ainsi, lors d’une demande d’AMM ou de certaines demandes de modification de l’AMM, l’avis aux demandeurs exige la soumission d’une déclaration signée (« QP declaration ») par la personne qualifiée du site de fabrication et/ou de certification des lots du produit fini attestant que la substance active utilisée est fabriquée conformément aux bonnes pratiques de fabrication.
Concernant les excipients mis en œuvre dans les médicaments destinés à un usage humain ou vétérinaire, il n’existe pas de référentiel opposable dans la réglementation nationale ou européenne et ils ne sont pas soumis à une « QP declaration » dans le dossier d’AMM. C’est au fabricant ou au distributeur du produit fini de définir dans son système qualité le ou les référentiel(s) applicable(s) pour la fabrication ou la distribution de l’excipient, selon leur(s) utilisation(s) prévue(s). Cet exercice se fera en concertation avec les usagers pharmaceutiques sur la base des résultats obtenus lors d’une évaluation formalisée des risques qualité (point 5.29 des BPF). A noter que l’ANSM recommande, a minima, les référentiels métiers de type IPEC/PQG GMP & GDP.
Cependant, il est reconnu que pour certaines matières premières, leur utilisation pharmaceutique peut ne représenter qu’une fraction mineure de leurs autres utilisations industrielles (agro-alimentaires, cosmétiques ou autres). Ainsi, leurs producteurs peuvent ne pas avoir pour objectif de répondre aux exigences spécifiques des clients pharmaceutiques.
Les Q&A Part 1 de l’EMA réaffirment que la conformité aux référentiels précédemment cités est une obligation légale et qu’en cas de difficultés pour garantir un approvisionnement de qualité satisfaisante des sources alternatives « GMP » doivent prioritairement être recherchées, qualifiées et si besoin enregistrées. En cas de source identifiée sur le territoire européen, l’établissement devra faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’enregistrement auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel il est établi. En cas d’importation d’un pays tiers vers le territoire européen, la source de substance active identifiée sera conditionnée par la fourniture d’une confirmation écrite de l’autorité compétente du pays tiers exportateur. Ce document atteste que les normes applicables sont au moins équivalentes aux BPF définies par l’Union européenne.
Dans des circonstances exceptionnelles ces mêmes Q&A Part 1 de l’EMA introduisent la possibilité aux détenteurs d’autorisation de fabrication (du produit fini) d’évaluer et de documenter dans quelle mesure les BPF sont respectées, et de fournir une justification basée sur les risques pour l’acceptation de toute dérogation. Au niveau de l’AMM la déclaration fournie par la personne qualifiée (« QP declaration ») doit exposer en détail le rationnel permettant de déclarer que les normes appliquées offrent le même niveau d’assurance que les BPF. L’EMA recueillera l’expérience acquise avec cette approche, qui pourra être utilisée comme base de discussion pour d’éventuelles futures modifications connexes des lignes directrices.
Toutefois, au niveau national, l’ANSM ne prévoit pas exemple pas explicitement de modalités dérogatoires ou bien sous circonstances exceptionnelles, contrairement à l’EMA pour les AMM centralisées. Informées en amont d’un contexte particulier (tel que les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) ou l’absence d’alternative thérapeutique), les autorités compétentes pourraient alors solliciter des informations complémentaires ou procéder à une inspection afin de s’assurer de la conformité de l’établissement vis-à-vis des référentiels en vigueur dans l’union. Ainsi cette situation ne peut donc qu’être transitoire puisque ces sources alternatives (en UE ou pays tiers) et/ou leur donneur d’ordre peuvent solliciter une demande expresse d’inspection de MPUP auprès d’une autorité compétente d’un des Etats membres en vue d’obtenir un certificat de conformité.
La maîtrise de la chaine d’approvisionnement est bien le maitre mot. Les déficiences dans le processus de qualification et de suivi des fournisseurs et/ou des fabricants de MPUP fait ainsi régulièrement l’objet d’injonctions prononcées par l’ANSM à l’encontre d’établissements pharmaceutiques (2 pour l’année 2024 et 2 pour l’année 2025). Pour la source alternative identifiée cela peut donc être un frein (contrainte de se conformer aux référentiels opposables) ou une opportunité (s’y conformer pour rentrer sur le marché UE des MPUP). Une mutualisation des approvisionnements (et des audits sur site) peut aussi être une approche interessante afin de l’inciter à saisir cette opportunité.
Article rédigé par Véronique LEWIN, Consultante Sénior en Affaires Pharmaceutiques – CMC