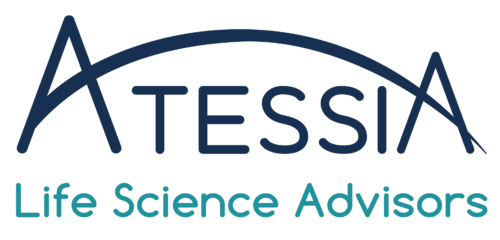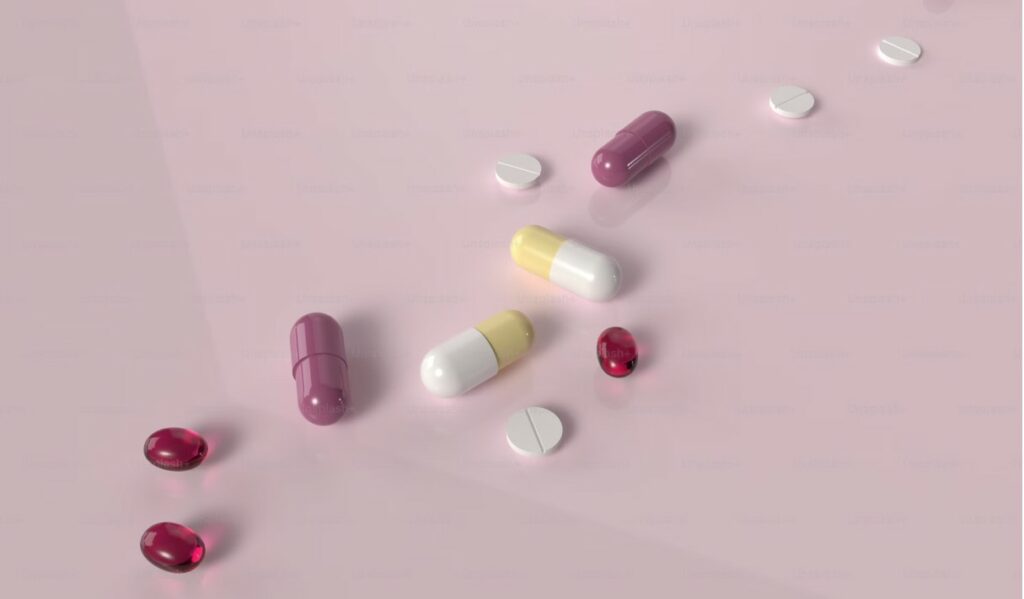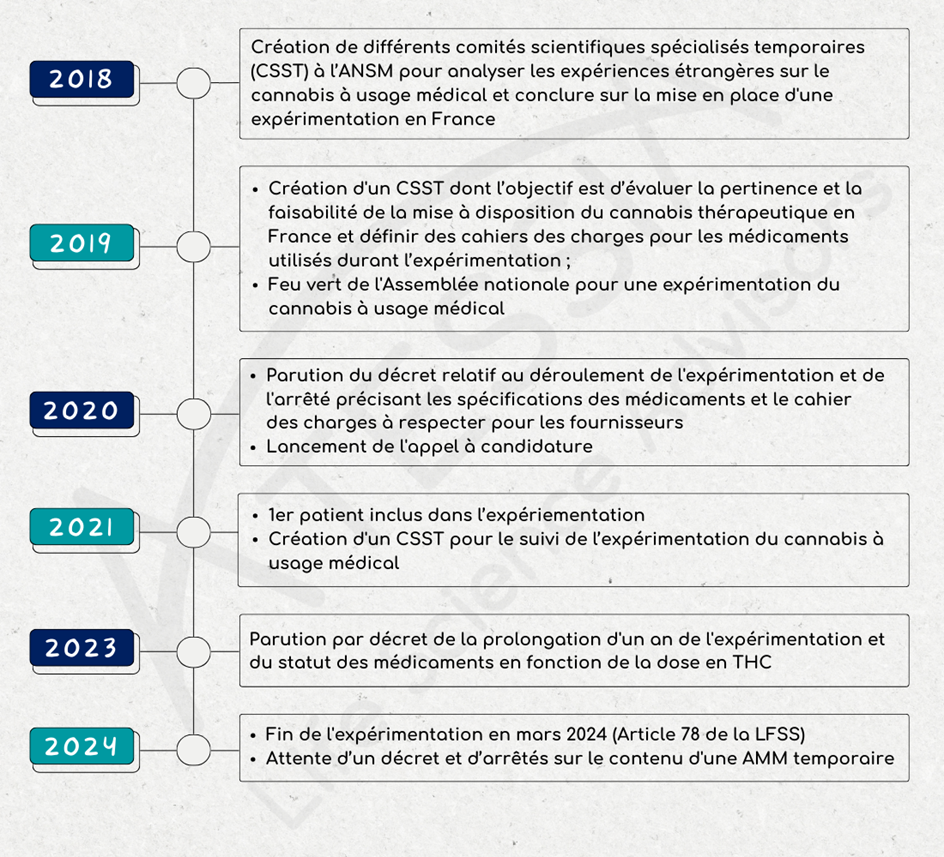Comment ouvrir un établissement pharmaceutique en France ?
1. Quel statut pour mon établissement ?
En France, le Code de la Santé Publique (CSP) définit différents statuts :
| Statut | Activités autorisées |
| Fabricant | Fabrication de médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du CSP |
| Importateur | Importation, stockage, contrôle de la qualité et la libération des lots de médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 en provenance : D’États non-membres de la Communauté européenne et non parties à l’accord sur l’Espace économique européen Ou d’autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque les médicaments, produits ou objets ont été fabriqués par un établissement non autorisé au titre l’article 40 de la directive 2001/83 du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain |
| Exploitant | Exploitation de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, de générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l’article L. 4211-1. |
| Dépositaire | Stockage de médicaments, produits, objets ou articles dont elle n’est pas propriétaire, en vue de leur distribution en gros et en l’état pour d’ordre et pour le compte : d’un ou plusieurs exploitants de médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° de l’article L. 4211-1 ; ou d’un ou plusieurs fabricants ou importateurs d’objets de pansement ou articles présentés comme conformes à la Pharmacopée mentionnés au 2° de l’article L. 4211-1 du CSP |
| Grossiste-répartiteur | Achat et stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l’état |
| Distributeur en gros de produits pharmaceutiques autres que les médicaments | Achat et stockage de produits intermédiaires destinés à une transformation ultérieure par un fabricant autorisé ou de produits, objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 4211-1, en vue de leur distribution en gros et en l’état |
| Distributeur en gros à l’exportation | Achat et stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, de produits, objets, articles, générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 4211-1, de plantes médicinales mentionnées au 5° de l’article L. 4211-1, en vue de leur exportation en l’état |
| Distributeur en gros à vocation humanitaire | Acquisition à titre gratuit ou onéreux et stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros ou de leur exportation |
| Distributeurs de médicaments expérimentaux | Stockage de médicaments expérimentaux fabriqués ou importés par des entreprises ou organismes définis au 1° ou au 2° du présent article (R.5124-2), en vue de leur distribution en l’état pour ordre et pour le compte d’un ou plusieurs promoteurs définis à l’article L. 1121-1 |
| Distributeur en gros de plantes médicinales | Stockage et contrôles et opérations nécessaires pour la distribution en gros et en vrac, en sachets-doses, en fragments ou à l’état frais ou desséché de plantes médicinales mentionnées au 5° de l’article L. 4211-1 ; |
| Distributeur en gros de gaz à usage médical, | Achat et au stockage de gaz à usage médical conditionnés, en vue de leur distribution en gros et en l’état ; |
| Distributeur en gros du service de santé des armées | Distribution en gros et en l’état des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 5124-8 ; |
| Établissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, | Opérations d’achat, de fabrication, d’importation, d’exportation de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, en vue de leur distribution. |
| Centrale d’achat pharmaceutique, | Achat et stockage des médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état à des pharmaciens titulaires d’officine soit en son nom et pour son compte, soit d’ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d’officine ou des structures mentionnées à l’article D. 5125-24-16 |
Certains statuts sont cumulatifs pour tout ou partie d’une activité liée à son statut pour un même établissement juridique.
Exemple : un établissement pharmaceutique peut répondre du statut d’Exploitant et répondre au statut fabricant limité à la certification des lots.
2. Qui délivre l’autorisation d’ouverture ?
Le Code de la Santé Publique précise que l’autorisation d’ouverture d’un établissement pharmaceutique est délivrée par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Cette autorisation d’ouverture est rendue publique sur EudraGMP. Le démarrage de l’activité nécessite donc une autorisation préalable de l’ANSM afin de s’assurer de la conformité du projet à la réglementation et de vérifier que les moyens nécessaires sont disponibles et qu’ils seront bien mis en œuvre. Cette opération peut relever d’un défi, par exemple quand un accès précoce est sur le point de démarrer, ou qu’un médicament est en lancement. En effet, l’Exploitant doit être désigné.
L’avis du conseil central compétent de l’ordre national des pharmaciens est requis dans un délai de 2 mois pour toute ouverture d’établissement pharmaceutique à l’exception d’un établissement pharmaceutique dépendant de la pharmacie centrale des armées ou des établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées
À l’issu des 2 mois, le Directeur Général de l’ANSM peut statuer.
3. Comment constituer son dossier ?
Pour l’ouverture d’un établissement pharmaceutique, le site de l’ANSM et à disposition 3 types de dossiers en fonction du statut souhaité :
- Dossier fabricant / importateur
- Dossier Exploitant
- Dossier Distributeur
En cas de cumul d’activité, comme notre exemple ci-dessus par exemple, 2 dossiers sont à compléter.
Le dossier à déposer doit être conforme à la décision du 1er octobre 2019 relative à la présentation des demandes d’autorisation d’ouverture et de modification des autorisations initiales des établissements pharmaceutiques mentionnés à l’article R. 5124-2 du code de la santé publique, à l’exception des établissements relevant du ministre chargé des armées (cf. Article R. 5124-5 du CSP).
Un tel projet comporte des axes de vigilance incontournables pour le mener à bien. La constitution du dossier nécessite de définir le statut adéquate en fonction de l’activité souhaitée, d’anticiper la mise en place de l’organisation souhaitée pour rédiger un dossier le plus conforme à ce qui sera réalisé dans le futur établissement ainsi qu’à la réglementation en vigueur. L’ANSM est notamment attentive aux aspects de responsabilités pharmaceutiques, de respect des GxP et de sécurisation des locaux. L’identification en amont du pharmacien responsable est un point crucial.
4. Quel délai d’instruction ?
Aucune opération pharmaceutique ne peut être réalisée au sein de l’établissement tant que l’autorisation d’ouverture n’a pas été obtenue.
En fonction de l’activité souhaitée, le demandeur fait un dossier de demande d’autorisation d’ouverture auprès de l’ANSM via la plateforme dédiée sécurisée « Démarches Simplifiées ».
Le Code de la Santé Publique impose au Directeur Général de l’ANSM de notifier sa décision dans un délai de 90 jours.
Une fois le dossier soumis par le Pharmacien Responsable du futur établissement via « Démarches Simplifiées », Le Pharmacien Responsable reçoit un email accusant réception du dossier.
La période de recevabilité commence. Elle dure 30 jours à compter de la date de réception du dossier par l’ANSM et permet d’analyser le contenu du dossier : Pièces manquantes au dossier, nommage des pièces non respecter, etc. En l’absence de sollicitation de la part de l’ANSM dans les 30 jours, le dossier est dit « recevable » et l’instruction peut commencer.
ANSM peut solliciter le demandeur afin d’obtenir toute information complémentaire. Le délai de 90 jours est alors suspendu à compter de la date de notification au Pharmacien Responsable de la demande d’informations complémentaires par le directeur général de l’ANSM, jusqu’à la réception de l’information demandée.
L’ANSM peut aussi diligenter une inspection pendant la période d’instruction pour s’assurer de l’exactitude des informations fournies par le demandeur.
Le silence gardé par l’administration à l’expiration de ce délai de 90 jours vaut :
- refus d’autorisation pour les demandes d’ouverture fabricant et importateur.
- autorisation tacite pour les autres établissements.
Ces dernières années, Atessia a ouvert, modifié ou déménagé plus d’une dizaine d’établissements pharmaceutiques.
Cet article a été rédigé par Isabelle BARBIEUX, Consultante Sénior en Assurance Qualité.