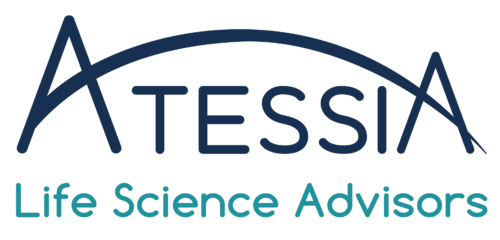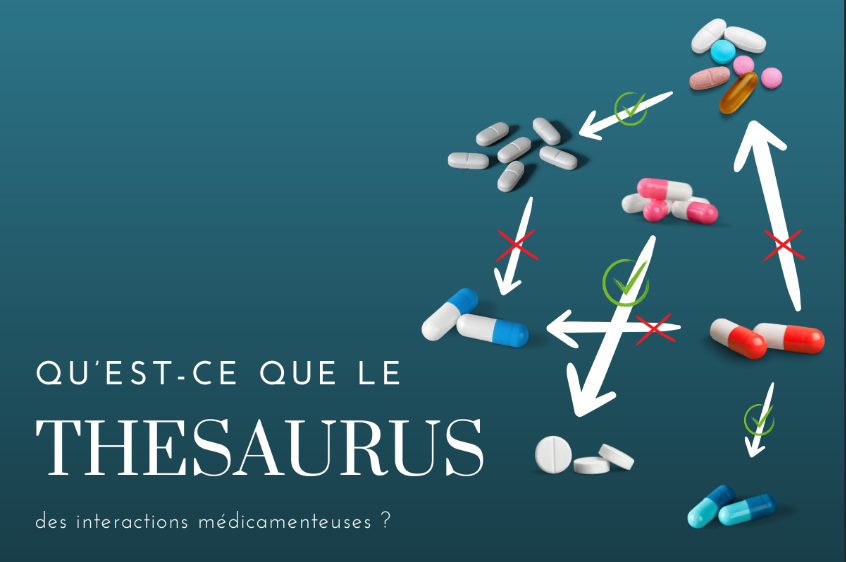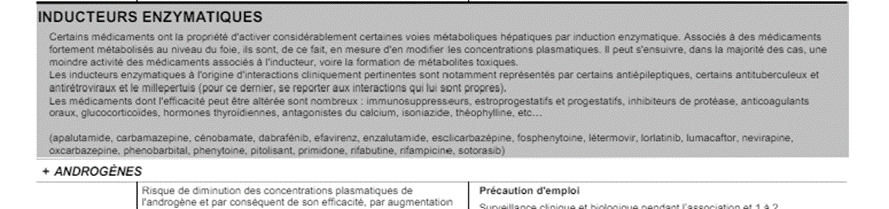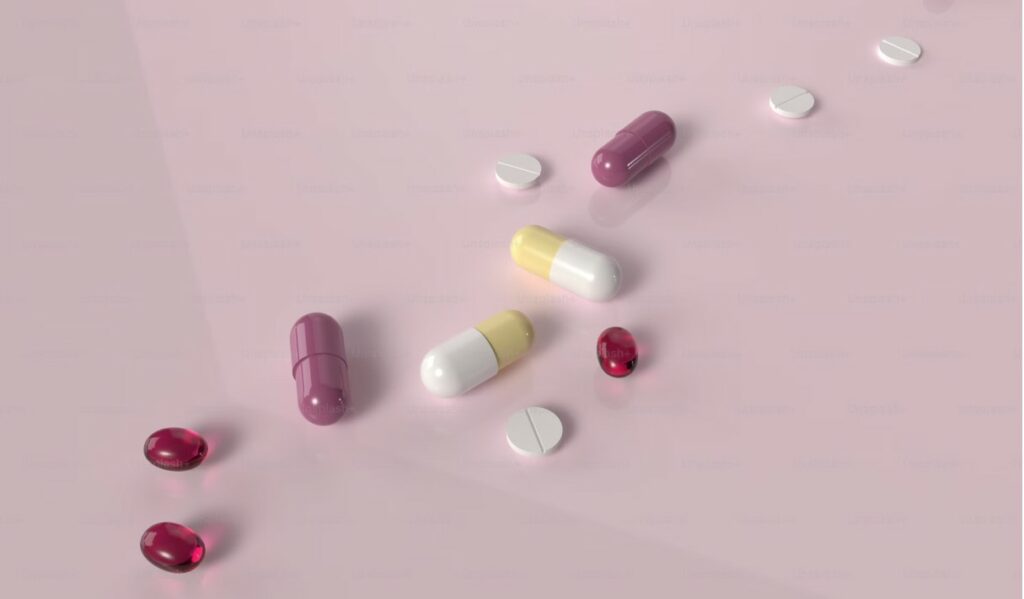Quelle substitution des médicaments biologiques en France?
Les médicaments biologiques sont utilisés dans le traitement de nombreuses pathologies telles que le diabète, les cancers et les maladies auto-immunes. Tout médicament biologique dont le brevet est tombé dans le domaine public peut être copié: il s’agit d’un « biosimilaire ». Un médicament biosimilaire est un médicament qui, comme tout médicament biologique, est produit à partir d’une cellule, d’un organisme vivant ou dérivé de ceux-ci, et dont l’efficacité et les effets indésirables sont équivalents à ceux de son médicament biologique de référence. Notons qu’en février 2022, 67 médicaments biosimilaires étaient autorisés dans l’Union européenne.
L’autorisation de mise sur le marché d’un médicament biosimilaire
L’autorisation de mise sur le marché d’un médicament biosimilaire répond à des exigences réglementaires strictes afin de démontrer que sa qualité pharmaceutique, son efficacité et sa sécurité sont cliniquement équivalents à ceux du médicament biologique de référence. L’ANSM tient à jour la liste de référence des groupes biologiques similaires enregistrés en France. Elle est présentée par dénomination commune de la substance active. Elle comporte l’ensemble des médicaments enregistrés en France avec la base légale de dossier d’AMM « biologique similaire » au sens du b du 15° de l’article L5121-1.
S’agissant de médicaments issus du vivant, les médicaments biosimilaires ne peuvent être strictement identiques aux produits de référence. Par conséquent, le principe de substitution, valable pour les médicaments chimiques et leurs génériques, ne peut pas s’appliquer automatiquement.
Cependant, au vu de l’évolution des connaissances, une interchangeabilité et une substitution en primo-prescription ou en cours de traitement peut aujourd’hui être envisagée dans des conditions strictes et dans le cadre des indications, des schémas posologiques et des voies d’administration communes au médicament de référence.
Afin de garantir le bon usage et la sécurité d’utilisation lors de la substitution, cette dernière est mise en place de manière progressive en France. Le droit à la substitution pour les biosimilaires est décidé à l’échelle nationale par chaque Etat membre. En France, l’arrêté du 12 avril 2022 a d’abord fixé les deux premiers groupes de biosimilaires substituables en officine dans un cadre précis, le filgrastim et pegfilgrastim (agents immunostimulants-cytokines).
Plus récemment
Plus récemment, l’arrêté du 31 octobre et l’arrêté du 20 février 2025 sont venus élargir la liste des groupes biologiques similaires substituables par le pharmacien d’officine et préciser les conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient:
- Filgrastim (2022)
- Pegfilgrastim (2022)
- Ranibizumab (2024)
- Adalimumab NEW
- Enoxaparine NEW
- Epoétine NEW
- Etanercept NEW
- Follitropine alfa NEW
- Teriparatide NEW
Que retenir sur la substitution des biosimilaires en France ?
> Prescription
Le prescripteur doit informer le patient de la possibilité de substitution par le pharmacien du médicament biologique prescrit. Il peut également indiquer sur la prescription quel type de dispositif médical d’administration est à privilégier pour un patient donné (adalimumab, étanercep, tériparatide).
> Délivrance
Lors de la dispensation, le pharmacien doit informer le patient de la substitution effective et des informations utiles associées, en rappelant notamment les règles de conservation de la spécialité. Il – mentionne sur l’ordonnance le nom du médicament effectivement dispensé et informe le prescripteur quant au médicament dispensé. Il enregistre le nom du médicament délivré par substitution et son n° de lot par tous les moyens adaptés afin de mettre en œuvre la traçabilité requise pour tous les médicaments biologiques. Enfin, il assure la continuité de la dispensation du même médicament lors des dispensations suivantes.
Pour les spécialités suivantes il doit également :
– substituer des spécialités de même dosage en substance active : Etanercept, adalimumab, énoxaparine, époétine
– ne pas substituer par un biosimilaire qui aurait un volume d’injection supérieur au médicament prescrit : Adalimumab
Pour follitropine αlfa, le pharmacien :
– dispense une spécialité qui permette l’administration de la posologie exacte prescrite en cas de substitution de stylos multidoses par des stylos unidoses et inversement,
– s’assure que le patient possède le stylo adapté en cas de dispensation de cartouches et accompagne le patient à l’apprentissage du nouveau dispositif,
– dans le cadre d’une stimulation ovarienne, s’assure de la compréhension du protocole mis en place incluant le schéma posologique prescrit et des modalités d’administration de la spécialité dispensée.
> Le patient a la possibilité de revenir à la spécialité initialement délivrée si nécessaire, « en fonction de ses retours » (adalimumab, enoxaparine, epoétine, étanercep, follitropine alfa, tériparatide).
> Enfin, le laboratoire met à disposition des dispositifs d’administration factices auprès des professionnels de santé et des patients (adalimumab, enoxaparine, epoétine, étanercep, follitropine alfa, tériparatide).
Atessia suit ce sujet évolutif au jour le jour.
Glossaire :
- Médicament biologique (article L5121-1, alinéa 14 du Code de la Santé Publique) : “tout médicament dont la substance active est produite à partir d’une source biologique ou en est extraite et dont la caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison d’essais physiques, chimiques et biologiques ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de son contrôle ”.
- Médicament “biosimilaire” (article L5121-1, alinéa 15 du Code de la Santé Publique) “tout médicament biologique de même composition qualitative et quantitative en substance active et de même forme pharmaceutique qu’un médicament biologique de référence mais qui ne remplit pas les conditions prévues au 5° du présent article pour être regardé comme une spécialité générique en raison de différences liées notamment à la variabilité de la matière première ou aux procédés de fabrication et nécessitant que soient produites des données précliniques et cliniques supplémentaires dans des conditions déterminées par voie réglementaire”.
- Médicament de référence : médicament biologique approuvé dans l’UE qu’une société mettant au point un médicament biosimilaire choisit comme point de référence pour la comparaison directe de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité.
- Interchangeabilité : désigne la possibilité de remplacer un médicament par un autre médicament censé avoir le même effet clinique. L’interchangeabilité peut s’opérer de deux façons :
- Permutation : le fait, pour le prescripteur, de remplacer un médicament par un autre médicament avec la même intention thérapeutique.
- Substitution : pratique consistant, pour le pharmacien, à délivrer un médicament à la place d’un autre médicament équivalent et interchangeable sans en référer au prescripteur.
Cet article a été mis à jour par Estelle ICARD.