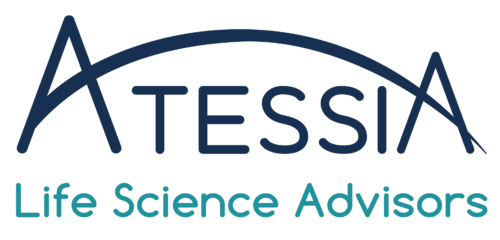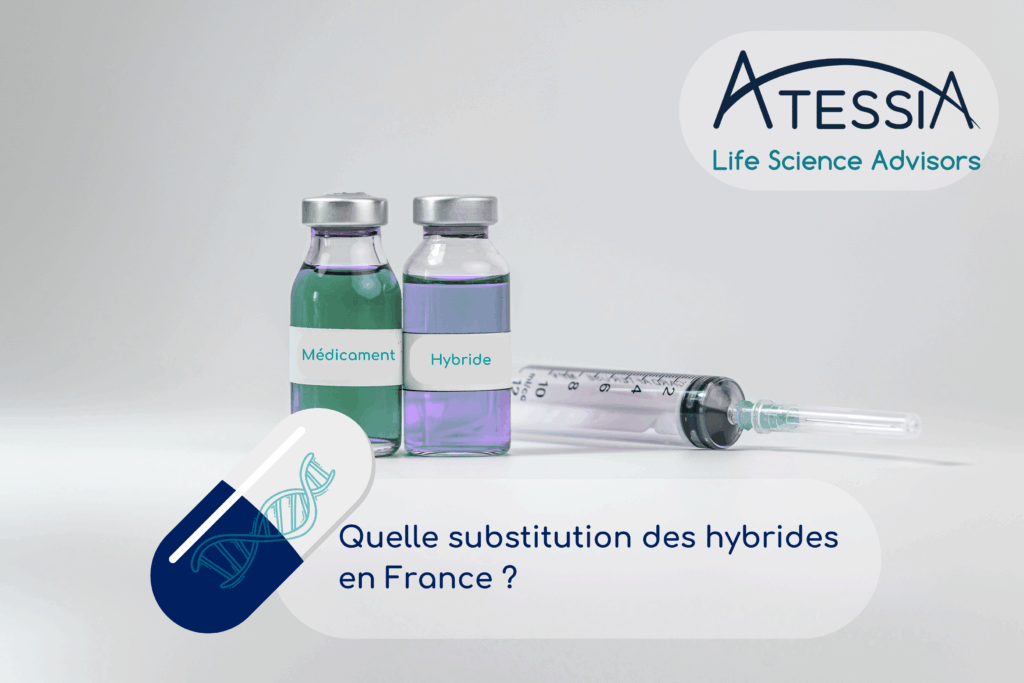Quelle substitution des hybrides en France ? Etat des lieux du Registre des groupes hybrides de l’ANSM
Une création laborieuse du registre des groupes hybrides
Le but du registre des groupes hybrides est de permettre une substitution dans certaines situations médicales en considérant la variété des situations « hybrides ».
Ainsi, la création du registre des groupes hybrides est issue d’un long processus législatif en France ayant mené à la création des groupes hybrides et du registre des groupes hybrides pour tenir compte des risques potentiels liés à la substitution :
1- les prémices ont été introduits avec la loi LFSS pour 2019 et son décret n°2019-1192 du 19 novembre 2019 : ces textes ont posé les fondations avec la définition du registre des hybrides, et un premier cadre pour la substitution ;
2- vient ensuite l’arrêté du 12 avril 2022 : il s’agit de la première liste des classes ATC R03A & R03B de médicaments pouvant faire l’objet de groupes inscrits au registre des hybrides, c’est-à-dire les médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires administrés par voie inhalée. Depuis, de nouvelles classes ATC ont été ajoutées ;
3- de nouvelle précisions sont données dans les arrêtés du 31 janvier 2023 avec les situations médicales :
- dans lesquelles la substitution est possible ;
- dans lesquelles le médecin peut exclure la substitution ;
4- enfin, tout démarre effectivement avec la décision de l’ANSM du 22 avril 2024 : la création du registre des groupes hybrides et l’inscription de produits dans ce registre permettant les première substitutions sur le terrain officinal.
Une variété de produits hybrides
Les médicaments hybrides sont définis dans le code de la santé publique (articles L5121-1 5°c) et R5121-28)) et à l’article 10(3) de la directive 2001/83/CE comme des médicaments ne répondant pas à la définition du médicaments génériques :
- en raison des différences relatives à la substance active, aux indications thérapeutiques, au dosage, à la forme pharmaceutique ou à la voie d’administration,
- ou lorsque la bioéquivalence par rapport à cette spécialité de référence n’a pu être démontrée par des études de biodisponibilité.
Cette définition regroupe donc une large variété de situations : citons les médicaments topiques pour lesquels une biodisponibilité n’est pas réalisable du fait d’un mode d’action local (ex : dermatologique, ophtalmique ou pulmonaire), des médicaments parentéraux avec une variété de présentations pharmaceutiques, ou encore des médicaments disposant, pour des raisons historiques, d’indications thérapeutiques hétérogènes.
Le contenu du dossier dépend de la raison pour laquelle le médicament est hybride. Dans bien des situations, la substitution en officine n’est pas anodine.
Néanmoins, notons que comme pour les médicaments génériques, les AMM des médicaments hybrides se réfèrent pour partie aux données non cliniques et/ou clinique d’un médicament de référence ayant une AMM depuis plus de 8 ans en France ou dans l’Union Européenne.
Outre cette définition, le code de la santé publique définit :
- Le groupe hybride comme le regroupement d’une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides pouvant lui être substituées (article L5121-1 5°d)).
- Le registre des groupes hybrides comportant les groupes hybrides substituables (article L 5121-10).
En pratique
Contrairement aux spécialités génériques, l’inscription dans le registre de groupes hybrides n’est pas automatique. Toutefois, il n’est pas demandé au laboratoire d’en faire la demande : c’est l’ANSM qui évalue la légitimité d’inscription du produit.
Les groupes hybrides sont classés par substance active désignée par sa dénomination commune.
Comme pour le répertoire des génériques, les spécialités figurant au registre sont classées par groupe hybride. Chaque groupe comprend la spécialité de référence (identifiée par la lettre « R ») et ses hybrides (identifiés par la lettre « H »).
Le registre des groupes hybrides indique, pour chaque spécialité, son nom, son dosage, sa forme pharmaceutique ainsi que le nom du titulaire de l’AMM et, s’il diffère de ce dernier, le nom de l’exploitant la spécialité, ainsi que, le cas échéant, la nature des différences constatées entre une spécialité hybride et la spécialité de référence. Les excipients à effet notoire sont également inclus dans ce registre. Enfin, les situations médicales pour lesquelles la substitution peut être réalisée sont également précisées le cas échéant.
La décision d’inscription est faite au cas par cas et est sous la responsabilité du Directeur Général de l’ANSM.
Dans les premières versions du registre, seules les spécialités appartenant aux classes thérapeutiques R03A et R03B utilisées pour les maladies obstructives pulmonaires ont intégré le registre des groupes hybrides. Des spécialités appartement aux classes ATC relatives à des médicament utilisés en dermatologie (D01A, D05A et D08A) et relatives à des médicaments utilisés en ophtalmologie (S01A et S01E) ont été ajoutées par décision de l’ANSM en octobre 2025.
Nous attendons de nouvelles inscriptions pour les classes ATC ci-dessous :
- A01AB – Préparations stomatologiques – Anti-infectieux et antiseptiques pour traitement oral local
- D11A – Médicaments dermatologiques – Autres préparations dermatologiques
- R02A – Préparations pour la gorge – Préparations pour la gorge
- S02A – Médicaments otologiques- Anti-infectieux
Ainsi, le registre des hybrides a commencé avec un échantillon de médicaments respiratoires, puis dermatologiques et ophtalmologiques. Il devrait continuer à s’élargir dans les années à venir.
Atessia accompagne ses clients dans la stratégie d’enregistrement en Europe des médicaments de base légale hybride.
Article rédigé par Agathe DAUBISSE, Consultante Sénior Affaires Réglementaires